





 |
|

|
Peter Parker a renoncé à son idylle avec Mary Jane Watson dont il est fou amoureux, a perdu son job de livreur de pizza, devient l’un des pires élèves de sa promotion... Car Peter Parker est aussi Spider-Man, et cette double identité est bien difficile à assumer. Tandis qu’il songe à abandonner sa mission de justicier, un ennemi mortel voit le jour : le Dr. Octopus.
|
|
|

Retour sur l’une – la meilleure - des affiches du film : Spider-Man, de dos, tête nue, son masque à la main. Devant lui s’étend le paysage cimenté de New-York, éclairé par le soleil couchant. Deux détails qui font toute la profondeur et la substance du film, deux oppositions : Spider-Man / New York et Spider-Man / Peter Parker. La force de
|
|
cette affiche, c’est d’avoir parfaitement retranscrit, en un plan, l’enjeu du film. La force de Sam Raimi, c’est d’avoir si bien assimilé et digéré la mythologie créée par Stan Lee qu’il peut aujourd’hui la détourner et la confronter à des tourments bien plus grands que ceux imaginés pour la bande dessinée. Et aujourd’hui, comme suggéré par l’affiche, l’ennemi principal de Parker c’est lui-même, ou plutôt son double, renforcé par la ville de New York post 11/09 qui, de par l’insécurité dont elle est la proie, ne lui laisse plus aucune vie privée. Réelle nouveauté pour un film qui en compte d’innombrables, et véritable preuve d’intelligence de la part d’un cinéaste capable – il l’a prouvé par le passé - de tourner en dérision ses personnages sans jamais les ridiculiser, isolant cette
| |
fois le super-héros au milieu d’un univers hostile, où chaque détail insignifiant constitue un obstacle. Déconstruisant littéralement une icône pour mieux la recréer, Sam Raimi se la réapproprie dès son sublime générique, confiant le visuel à l’illustrateur Alex Ross qui a pour charge de peindre des aquarelles relatant les divers moments du premier film. Le passé de Spider-Man, c’est désormais celui de Raimi, de Koepp, celui inventé pour le cinéma. Spider-Man n’existe plus, vive Spider-Man ! Et l’araignée de Sam n’étant pas celle de Stan, le réalisateur peut faire œuvre d’iconoclaste, et bouleverser entièrement la légende mise en place dans la bande dessinée.
|
|
|
|
« With great power comes great responsibility ». Avons-nous le choix ? Superman 2 posait de façon incroyable-ment crétine la question, Batman 3 y répondait de façon incroyablement lourde (Bruce Wayne, une fois guérit de sa psychose, choisit de rester Batman). Sale temps pour un héros : Parker perd son boulot, ses amis, son amour, à cause de son alter ego et du temps que celui-ci néces-site. La première partie du film est ainsi le récit d’une impuissance et de la thérapie qui va conduire à sa guérison. Prodigieuse idée qui fait directement suite à la métaphore sexuelle du premier film, dans lequel la masturbation et l’éjaculation trouvaient leur représentation dans des jets de toile semblables à des jets de sperme. Après la puberté arrivent les |
|
premiers doutes, les premiers échecs. Et Sam Raimi d’imaginer toutes les situations les plus invrai-semblables et les plus jouissives pour plonger son héros dans l’embarras: absence soudaine de toile, chute, visite chez le médecin… Les scènes qui en découlent ont un potentiel comique que le cinéaste exploite à chaque fois et de façon astucieuse, à l’inverse d’un Richard Lester sur le retour (Superman 2 et 3). Mais l’obligation que Parker ressent et le poids qu’elle entraîne sur sa vie privée constituent désormais pour lui un blocage quasi sexuel. Spider-Man 2, au-delà de ses séquences d’action absolument inouïes (la scène du métro aérien est d’une virtuosité totalement inédite), c’est le récit d’un choix intime, choix qui fait lui-même suite à l’apprentissage du premier film. Spider-Man se concluait
|
|

sur la question " Who am I ?" à laquelle Parker ne répondait pas vraiment: humain ou insecte, ado ou héros. Face à l’adversité, Parker choisit aujourd’hui les deux, non par obligation, malédiction ou remord (la mort de son oncle Ben dont il s’estime responsable), mais bien par envie.
|
|
|

Sam Raimi, dont la person-nalité inonde chaque plan sans exception (aussi bien visuellement que théma-tiquement), illustre par un montage éblouissant et une mise en scène virtuose une histoire radicalement humaine. Chaque second rôle bénéficie de l’apport minutieux du scénariste et du réalisateur, chaque per-sonnage se trouve renforcée par une seconde, puis une troisième couche, y compris
|
|
le terrifiant Dr. Octopus, dont le seul défaut est d’avoir une relation avec Parker moins profonde que celle litté-ralement œdipienne que le héros entretenait avec le Green Goblin dans le premier épisode. Dans Spider-Man 2, chaque personnage retire son masque, faisant son propre choix – voir la dernière scène d’une émouvante pudeur -, et le véritable visage de chacun se met à jour. A ce titre, le parcours quasi christique qui fait directement suite à la prodigieuse scène du métro aérien déjà citée reste sans doute l’une des plus belles idées du film. Spider-Man appartient à New York, Spider-Man est New York, et ses habitants, soudés par le traumatisme du 11 septembre, ne font une fois de plus qu’un avec l’homme araignée. Bouleversante scène qui montré un héros exténué, plus humain que jamais, comme mis à nu, qui |
|
trouve un second souffle dans l’amour et le respect que lui portent les autres protagonistes. Et malgré la grandiloquence de cette scène, malgré l’émotion sans doute facile qu’elle dégage à l’image du reste du métrage, Sam Raimi remporte haut la main son pari pour la seconde fois, faisant de ce nouvel épisode un film imparfait, sans doute moins carré (parce que plus de per-sonnages, plus d’intrigues) que le précédent, mais ô combien plus attachant. Et si l’on peut parler de jouissance absolue pour le spectateur devant la perfec-tion de scènes d’action hal-lucinante, le premier mot qui vient à l’esprit à la vision de ce second opus est bien plus intime. L’émotion. Tout simplement. |
|
|

|
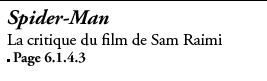 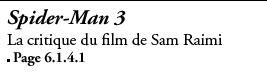 |