Tim Burton aime raconter des histoires. La notion même de narration se retrouve parfois projetée au cœur de ses films. S'il ne répond pas à la définition de conteur stricto sensu, il est profondément imprégné par cette culture et ces récits. Nourri par le monde de l'enfance, le réalisateur en a toujours renvoyé une vision douce-amère très personnelle. Analyse des figures classiques du conte dans ses films.
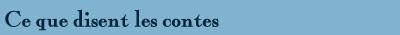
|  |
Contrairement à l'idée répandue, les contes ne sont pas des récits simplistes destinés à éduquer des enfants. Ce sont des histoires le plus souvent issues de la tradition orale et tirées du folklore. Toutefois, malgré leur caractère local, ils connaissent une part d’universalité. Plusieurs versions de la même chronique, dont les vraies origines sont le plus souvent inconnues. Des traits communs s’en détachent, se recoupent et se rejoignent pour en sortir un squelette caractéristique, une structure collective. A l’instar des récits archétypaux et mythologiques – dont le mythologue Joseph Campbell montre leur unicité fondamentale malgré la pluralité des formes – les contes participent à la construction de la mémoire humaine. Appuis des cultures populaires, religieuses ou bourgeoises, ils arborent les caractères des lieux où ils sont nés et du temps qui les a engendrés. La diversité des formes et des publics leur confère des fonctions variées. Mythe fondateur, il magnifie souvent son propre terreau en transformant ses hommes en élus des Dieux. Dans la tant décriée Planète des singes, Tim Burton y livre sa vision des origines quasi-sacrées d’un peuple singe prenant le pas sur des humains sous-adaptés à la technologie. Depuis les légendes archaïques jusqu’aux histoires des frères Grimm, d’Andersen ou de Charles Perrault, le conte se fraie une voie complexe et non gratuite. Critique sociale, rebut de croyances, morale pieuse, rêves du réel et récits de voyages fantasques, il se décline en milliers de formes. On ne recense plus les histoires d’hommes s’en remettant au diable pour qu’il l’aide, ou les nursery rhymes anglaises, ces comptines pouponnières. Princes, paysans, rois et voleurs, oiseaux magiques et bonnes fées, injustices, malédictions, travaux harassants, les contes sont des témoins, des mémoires vivantes, sagaces et qui en disent plus sur une peuplade que n’importe quel discours. Mieux encore, quel que soit l’habit que choisit le conte, son âme universelle rassure sur les liens qui unissent, l’air de rien, l’humanité.


| |
On a beaucoup parlé d’un Tim Burton sous perfusion de séries B et autres serials, nourri à la SF cheap et gavé de comic books. Si son passé d’illustrateur parle pour lui, il est aussi fortement marqué par les arts naïfs et populaires, les histoires enfantines du patrimoine. Bien qu’il réfute une quelconque veine littéraire – il avoue détester lire à l’exception du Dr Seuss, l’auteur du Grinch – l’homme n’en est pas moins un érudit, parfaitement au fait des artifices de la narration. Ses premières armes artistiques flirtent avec le conte, Vincent, son premier court métrage – et chef-d’œuvre – se situe à la croisée des chemins, quelque part entre les films d’épouvante et le récit de l’enfant, éternel incompris. Œuvre de jeunesse certes, mais une maîtrise inattendue du thème sous-jacent de l’histoire reprenant et enrichissant le patrimoine du passé. Les esquisses et poèmes de La Triste fin du petit enfant huître sont la preuve du goût de Burton pour le récit simple en apparence mais profond. Ce n’est finalement pas par hasard que Tim Burton a débuté chez Walt Disney, lui-même grand pourvoyeur de contes. Ce rapport intime – et souvent dénié par les fans ardents de Burton – a probablement influencé de façon déterminante sa manière de concevoir les aventures de ses héros. Et s’il s’envole bien vite de la cage dorée du dessinateur disneyen, il ne reniera pas pour autant ce passé d’enlumineur. Voilà d’ailleurs ce qui distingue Burton du vrai conteur. Ses fictions ne sont pas racontées, elles ne sont pas dites, mais elles sont illustrées, dessinées. Son talent passe d’abord par l’image, c’est un peintre, avide ministre du langage cinématographique prêchant pour ses galeries de personnages insolites et archétypaux.

|  |
Pingouins rejetés, chats bottés de cuir, singes parlants, poissons métempsychotiques ou chiens zombies, le bestiaire burtonien apporte une nouvelle preuve des ponts jetés par le réalisateur vers les contes. Ceux-ci parlent souvent du sort de nombreux animaux aux particularités magiques et anthropomorphiques. La nature comme réceptacle et source de merveilleux, puisqu’elle a été elle-même la première raison du questionnement de l’homme sur l’Invisible. Pour Tim Burton, on relit Le Roman de Renart sur grand écran. Les bêtes deviennent le miroir des défauts humains, ils sont rejetés ou montrent notre part de bestialité. Le Pingouin de Batman Returns a subi enfant l’intolérance de ses semblables et, une fois adulte, il leur oppose la vengeance et la cruauté. Autre lieu commun où se retrouvent Burton et contes de jadis: la forêt. Endroit enchanteur, maléfique, mystérieux, renfermé sur lui-même, il s’agit d’une récurrence les plus frappantes du réalisateur. Depuis les arbres hantés et torturés de Sleepy Hollow - où vivent indifféremment une sorcière et un cavalier sans tête – jusqu’aux bois d’Edward aux mains d’argent qui entourent le château de l’inventeur, les arbres deviennent des personnages à part entière. Ce sont des lieus où les règles de la logique et de la raison deviennent biaisées. La forêt bordant le village des Noces funêbres sert de styx, lieu de passage entre le monde des morts et celui des vivants. Elle devient aussi bien un procédé d'inversion de valeurs ou de corruption de la morale. La forêt figure les portes d’entrée vers un autre monde (L’Etrange Noël de monsieur Jack et Les Noces funêbres), bénéfique ou maléfique, selon l’effet recherché.


| |
L’Etrange Noël de monsieur Jack est un archétype dans les films burtoniens. Tout comme Vincent et Edward aux mains d’argent, Jack a été imaginé par Tim Burton qui a, par la suite, laissé le soin à une scénariste professionnelle (Caroline Thompson) et un réalisateur (Henry Selick) de mettre en forme son film. Il s’agit là de la genèse d’un conte nouveau et inédit, inspiré par les traditions du folklore anglo-saxon de Noël et d’Halloween. Une histoire peuplée de créatures prodigieuses où une micro-société reprend les attributs de celle dans laquelle évolue Tim Burton. Jack comporte encore un élément emprunté au conte: le narrateur. Celui qui dit, celui qui raconte et livre sa vision. D'ailleurs, on retrouvera ce conteur, accommodé de bien des façons, dans Vincent, Edward ou La Planète des singes. Avec son principe de sketches éclatés, Charlie et la chocolaterie permet de multiplier les comptines au sein d'un plus grand conte moral où l'enfant et son rapport au monde prend un rôle central. De son côté, Big Fish est construit comme véritable concentré de conte. La notion de vérité et de plausible, y est malmenée comme un bateau dans la tempête. Ici, Edward Bloom croise au cours de sa vie de nombreux personnages insolites ou grotesques. A coup sûr des rebus de contes. Entre rimailleurs sans talents, vrais ogres géants et chanteuses siamoises made in China, Burton inocule son imaginaire fait d’elfes, de sirènes et de fées. Tout comme le fils du bonimenteur tente de remonter le fil de son véritable père au travers de ses histoires, Burton distille sa propre identité en filigrane. Tout cela pour fabriquer des histoires qui enrichissent et rehaussent la vie par nature terne et morne. N’est-ce pas le plus bel hommage au conte et à sa mémoire d’airain?
Nicolas Plaire