





 |
|

|
Marv, brute épaisse, est accusée du meurtre d’une prostituée qu’il n’a pas tué. Il va se lancer à la poursuite de son assassin qu’il traquera à travers tout Basin City, ville du vice et du péché où l’on trouve également Dwight McCarthy qui devra défendre le quartier des prostituées face à la mafia et Jim Hartigan, opposé une fois de plus à un enfant de salaud.
|
|
|

Adaptation atypique d’un ro-man graphique culte, le pro-jet avait pourtant de quoi faire peur à ses débuts. Tout d’abord, il y a la car-rière récente du cinéaste, composée d’une trilogie fun mais peu inspirée ( Spy Kids) et de la |
|
conclusion ambitieuse mais décevante d’une saga entamée dix ans plus tôt avec El Mariachi. Sans s’attirer les foudres des fans autant qu’un Brett Ratner sur Superman, Rodriguez n’était pas un choix des plus rassurants. C’est alors qu’il a pris une décision qui allait annoncer toute la nature "à part" de l’entreprise. En effet, il déclare ne pas vouloir "adapter" Sin City mais la "traduire" littéralement à l’écran. En s’associant au créateur de la bande-dessinée (Frank Miller, ainsi promu coréalisateur), Rodriguez a achevé de convaincre qu’il allait retranscrire le plus fidèlement possible le comic book à l’écran, se servant carrément |
|
du film. Tout d’abord filmé entièrement sur fond vert en HD, Rodriguez a respecté le noir et blanc original, tout en multipliant les petites touches de couleur (comme dans la BD), avant de rajouter des décors intégraux (après hési- tation), évitant d’en faire un OVNI entre Pulp Fiction et Dog-ville. Immédiatement, Sin City se voit conférer un aspect absolument unique. Restait à voir si le parti pris, tant esthétique que théma- tique, allait passer à l’écran. Le résultat tant attendu et tant craint s’offre enfin à nos yeux pour être jugé et le verdict fluctuera sans doute selon les personnes. des cases comme storyboard |
|
|
|
Concernant l’adaptation en soi, le film est une véritable réussite. En s’appropriant l’esthétique épurée de la BD, le film adopte ce concept d'un monde manichéen déchiré entre le Bien et le Mal, la justice et l’injustice. Dichotomie symbolisée par un noir et blanc que viendront enrichir plusieurs touches de couleur, tantôt pour souligner la sensualité d’une nuit d’amour, tantôt la chaleur d’un bar à striptease, ou la simple violence graphique du sang, éclaboussé à tout va sur les visages des personnages. La plus grande surprise est de voir à quel point les éléments narratifs et visuels les plus extrêmes du matériau d’origine passent remarquablement bien à l’écran. Il y a tout d’abord |
|
cette voix off envahissante mais dans le bon sens du terme, nous plongeant dans l’esprit des personnages de manière à ce que l’on soit constamment avec eux. On pense également aux maquillages outranciers qu’ont dû subir les acteurs afin d’être identiques aux dessins de Miller, ou encore au découpage qui favorise souvent l’ellipse très courte pour aller d’une action à l’autre, au sein d’une même scène. Le montage aurait pu s’avérer malaisé, frôlant le faux raccord, mais la transition à l’écran se fait harmonieusement par une habileté dans le timing (savoir quand couper) et l’apport du plus simple des effets de style cinématographiques tel que le fondu enchaîné. Là où le Dick Tracy de Warren Beatty |
|
 pouvait se permettre
pouvait se permettre une charte graphique poussée (plans fixes, couleurs criardes, trognes exagérées) de par son aspect comic strip, impliquant un certain recul par rapport à l’illustration, Sin City n’avait pas droit à l’erreur. |
|
|

Il va de soi que la démar-che de Rodriguez restera à jamais discutable. On évoque la franchise Harry Potter, dont les deux premiers volumes furent portés de manière assez maladroite à l’écran, sous forme de paraphrases filmiques des romans initiaux. En réalité, l’œuvre de Rodriguez et Miller se rapproche plus du travail de Gus Van Sant sur Psycho qui souhaitait refaire le film de Hitchcock à l’identique en y ajoutant la couleur et certains plans que la censure n’avait pas permis |
|
à l’époque. Quel en est l’intérêt? Est-ce pertinent? D’aucuns diront qu’il ne s’agit pas là d’un essai touchant à l’expérimentation mais d’une relative incompétence concernant l’approche du réalisateur face à l’adaptation. Pouvait-il faire autrement? Certes. En a t-il décidé ainsi? Non. Robert Rodriguez a beau ne pas être un cinéaste des plus remarquables, il fait preuve ici d’une démarche à la fois auteurisante et d’une incroya-ble modestie. Frank Miller’s Sin City, c’est ainsi que s’intitule réellement le film. Il souhaitait adapter le roman graphique de Miller avec respect et c’est chose faite. La question reste à savoir si le film apporte une valeur ajou-tée à la collection de comics originaux. Les fans se réjouiront certainement de voir la bande-dessinée traduite de manière sublime mais la connaissance des BD n’est pas indispensable pour apprécier Sin City. A dire vrai, il sera probablement plus |
|
facile pour un connaisseur de plonger dans l’univers du film. Il est parfaitement concevable que Sin City puisse paraître froid et vide. En enchaînant des histoires- vignettes, parcourues de personnages archétypaux, plus proches de l’icône que du protagoniste approfondi, sur une intrigue basique, le métrage rappelle un Kill Bill adoptant une approche si-milaire et auquel on repro-chait déjà d’être quelque peu vain. A l’instar de ce lointain cousin, le film de Rodriguez et Miller est un hommage à un genre révolu, en l’occurrence celui du film noir à l’ancienne, qui faisait la joie des amateurs d’exploitation movies, ces films commerciaux où le sang coule à flot et la violence est le maître mot, qui donnèrent aux salles de cinéma les diffusant le sur-nom de grind houses (littéralement "abattoirs"). |
|
|

|
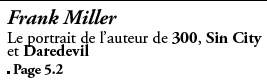  |